
Mrs St George a deux filles à marier : l’ainée, Virginia, sur laquelle tout le monde s’accorde à dire qu’elle est l’une des plus jolies jeunes filles de son âge, blonde comme les blés et d’une élégance altière ; et la cadette, Annabel, surnommée Nan, plus effacée que sa soeur, mais dont on admire la vivacité et l’indépendance d’esprit. Malheureusement pour elles et pour leur mère, la haute-société new-yorkaise les boude et bien que Virginia ait officiellement fait ses débuts dans le monde, aucune invitation aux événements mondains ne leur parvient. Alors qu’une des amies des filles épouse le fils d’un duc anglais, il leur vient une idée folle : et si Londres était plus accueillante ? Les voilà débarquant sur le sol anglais, se mêlant à la noblesse, tournant les têtes à mesure que les grandes dames de l’aristocratie sont choquées par leurs manières expansives et que les hommes sont séduits par leur beauté et leur naturel. Car « les boucanières », comme on surnomme alors ces tapageuses Américaines, fument, se maquillent et rient fort, s’immisçant peu à peu dans les plus grandes familles de l’aristocratie anglaise dont elles bousculent les codes poussiéreux.
« Elles incarnaient « la jeune fille américaine », ce que le monde avait réussi de plus parfait. »
Voilà donc Virginia et Nan, ainsi que leurs trois amies, lancées dans ce monde dont elles ne connaissent pas les codes. Tandis que les unes se fondent parfaitement dans le moule, virevoltant parmi les beaux partis et les belles toilettes, Nan est davantage attirée par l’atmosphère qui règne en Angleterre, sa culture, ses paysages et ses manoirs regorgeant d’Histoire. Elles sont conseillées dans leur entreprise par une vieille marieuse, ainsi que par Mrs Testvalley, leur gouvernante, très au fait des bons partis et qui les met en garde contre les mauvaises fréquentations, qui se résument surtout aux fameuses et redoutables divorcées. Le récit suit le destin des jeunes filles et leurs premiers succès, et en particulier Nan, à la nature sensible et que Mrs Testvalley cherche désespérément à protéger. C’est la plus innocente, la plus détachée des convenances et de l’importance du rang, celle qui préfère l’instruction aux mondanités, les promenades sur le bord de mer aux cérémonies interminables du thé. C’est malheureusement aussi pour cela qu’elle est la plus influençable, et celle qui risque le plus de se tromper sur les intentions de ceux qui lui feront la cour.
« La solitude pèse parfois très lourd lorsqu’il n’y a que les rêves qui vous semblent réels. »
Ce roman est souvent présenté comme le chef d’oeuvre d’Edith Wharton, sans doute en partie parce qu’il est son dernier, celui qu’elle n’a pu achever avant de mourir en 1937. Je dois avouer regretter énormément que le roman n’ait pas pu être terminé par la romancière américaine, puisque c’est la plume de Marion Mainwaring qui a complété le roman pour une seconde publication en 1993. Bien que le scénario souhaité par Wharton ait été connu, on sent un subtil changement de plume, et cela reste frustrant pour son lecteur de ne pas l’avoir vue parachever ce magnifique roman, comme cela avait été le cas pour Elizabeth Gaskell concernant Femmes et filles (dont le texte cette fois n’a pas été touché et laissé tel quel, incomplet).
« Elle se souvint de la médiocrité intellectuelle et morale qui régnait au pays natal, des bruyantes querelles qui surgissaient pour des riens, des préoccupations mesquines, de l’intérêt fiévreux que sa mère accordait aux moeurs et coutumes d’une société qui l’ignorait. En Angleterre du moins, le présent s’appuyait sur un passé, sur des couches et des couches d’un terreau riche et profond, formé d’histoire, de poésie, d’anciennes traditions, de demeures et de paysages admirables, de palais, d’églises et de cathédrales. Ne serait-il pas possible par quelque mystérieux stratagème, de se tailler une petite place parmi tous ces trésors et d’y mener une vie qui compenserait un tant soit peu l’absence de bonheur personnel ? »
On retrouve dans ce roman les grands thèmes de la romancière, et son mépris pour les mariages de convenance et le carcan de la haute-société, mais cette fois elle installe son récit en Angleterre et non dans le New-York huppé. Entre les lignes se dessine ce mélange de fascination et de répulsion qui existait entre Américains et Britanniques, un thème longuement traité par son contemporain et ami Henry James dans ses romans. Nous voilà aux frontières entre Ancien et Nouveau Monde, aux débuts du règne des affaires et de l’industrialisation, aux voyages qui favorisent l’ouverture progressive des esprits, à une modernité qui peu à peu se fait une place parmi les traditions. Les vieilles familles anglaises désargentées comptaient sur l’argent des riches Américaines pour restaurer leurs domaines délabrés et régler leurs nombreuses dettes, tandis que les nouveaux riches américains, ceux qui ne devaient pas leur fortune à une illustre ascendance mais aux bons coups à Wall Street, espéraient par le mariage au sein de l’aristocratie anglaise ouvrir des portes inespérées. Edith Wharton joue de sa délicieuse ironie pour raconter les travers de ses contemporains, n’occultant rien de la xénophobie anglaise et la méconnaissance totale de l’Amérique, comme en témoignent les nombreuses références aux sauvages indiens des grandes dames patronnesses ; ni de l’hypocrisie de ces parents prêts à tout pour acheter par le mariage soit un titre soit un compte un banque, au mépris total du bonheur de leurs enfants. Et les mariages malheureux sont légion dans ce roman…
« Une paix délicieuse, telle qu’elle n’en avait jamais connue, lui disait le coeur. Dans cet immense désert de la vie, elle avait un ami, oui, un ami qui comprenait non seulement ce qu’elle disait mais tout ce qu’elle ne pouvait pas dire. »
Il ne fait aucun doute cependant que Les Boucanières est l’un de ses grands romans, mon préféré aux côtés de Chez les heureux du monde. L’intrigue ne pourrait être plus différente, et pourtant on y retrouve cette fragilité du statut de la femme. Les jeunes Américaines sont riches mais la proie des chasseurs de dot, tandis que les femmes sans ressources, comme la truculente gouvernante, subissent les affres de la vie en manoeuvrant du mieux qu’elles le peuvent parmi leurs fortunés amis. Mariées, les voilà prisonnières d’un carcan insoutenable, trouvant parfois du réconfort auprès d’un amant au charme éphémère ; tandis que les divorcées sont vilipendées. Ce roman est sans doute celui qui illustre le mieux la subtile prise de pouvoir des femmes, qui font usage de leurs atouts, quels qu’ils soient, pour se tailler une part confortable dans une société patriarcale aux codes rigides. L’amour revient sur le devant de la scène, triomphe parfois, tandis que s’esquissent les prémisses des revendications féministes, et que certaines n’hésitent plus à réclamer leur indépendance, quel qu’en soit le coût. Le roman est en cela moins sombre que bien des romans d’Edith Wharton, sans doute influencée par la tournure prise par sa vie personnelle. Souffrant comme nombre de ses contemporaines de son mariage malheureux, elle fut l’une des rares femmes à l’époque à s’en être libérée par un divorce en 1913, trouvant enfin le véritable amour par la suite en France…
Ma note 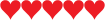 (5 / 5)
(5 / 5)
Éditions Points, traduit par Gabrielle Rolin, 17 juin 2010, 528 pages

